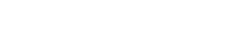2e texte sorti de l'atelier d'écriture.
Je le trouvais un peu "tragique-surfait", mais c'était pas l'impression qu'avaient les autres à l'atelier. Enfin, voilà.
La consigne cette fois était:
2303 (la date), bibliothèque, bras de robot armé et méchant
[N'oubliez pas d'ajuster la fenêtre du browser, c'est tellement plus agréable é lire ;) ]
[Nouvelle] Crescendo vers l'Eveil
13 message(s)
• Page 1 sur 1
[Nouvelle] Crescendo vers l'Eveil
Dernière édition par Christoph le 15 Jan 2004, 00:09, édité 1 fois.
- Christoph
- modo-admin
- Message(s) : 2949
- Inscription : 07 Sep 2002, 18:40
- Localisation : Yverdon, Suisse
Le texte
Crescendo vers l'Eveil
Un bras noir parcouru de reflets métalliques, recouvert de lames tranchantes et de pointes acérées, pendait le long du flanc monstrueux. La main tenait une épée à deux tranchants dont la pointe se trouvait à quelques centimètres au-dessus du sol. La main et l'épée semblaient réunies dans une symbiose cauchemardesque, inséparables soeurs siamoises. Homme devenu machine, cet être damné représentait l'apogée de l'évolution humaine, juge et bourreau à la fois.
L'autre bras était tendu rigidement devant le juge, exsudant une impression de puissance formidable, telle que rien ne pouvait le faire vaciller. La main droite serait en une étreinte implacable la gorge de la poétesse, surprise. En cinq point de la nuque et de la gorge, les griffes faisaient perler le sang, rosée perdue sur un pétale d'orchidée. Trois gouttes tachetaient la page ouverte du livre projeté au sol, tel des points de suspension de mauvaise augure.
“Vous avez été prévenue, Silénus,” condamne l'hybride d'une voix rauque et posée. “Néanmoins vous avez désobéie et vous devez donc être punie.”
La poétesse regarda autour d'elle. Ses yeux accueillirent lentement la vision des tomes rangés sur les rayons penchés des meubles antiques. Ils s'attardèrent un instant sur une fenêtre à l'arc brisé, au travers de laquelle elle pouvait voir le soleil mourrant sous un voile de nuages noirs et massifs défilant rapidement à l'horizon et qui répandait, comme un cœur perforé, sa lueur rouge sur le paysage.
Cette ruine perdue dans la zone interdite recelait donc effectivement bien plus que des grimoires moisis et déchirés. Ce savoir antique semblait poser un véritable dilemme au gouvernement… Cependant, il semblait étrange qu'un juge soit envoyé en ces lieux, alors qu'aucune patrouille ne s'y aventurait plus depuis des générations.
La poétesse réalisait progressivement l'importance de sa découverte des derniers jours. Elle se sentait toute proche du but. Comprendre les phénomènes dont parlent ces livres, s'extraire de la non-vie, de l'amputation émotionnelle à laquelle est livrée chaque citoyen dès son enfance. Connaître une alternative…
- Vous avez le choix: amnésie ou mort.
Panique soudaine. Terreur. Tout ce qu'elle avait appris lui serait ôté! Un niveau de conscience supérieur allait lui être refusé!
Des images de gens qu'elle… aimait? … lui filèrent devant les yeux. Un sentiment de tristesse sembla poindre...
Puis, elle comprit. La peur laissa place à une euphorie farouche, effaçant la douleur de la poigne d'acier. Finalement sereine, elle prononça d'une voix calme sa sentence.
- Je choisis de connaître.
:thesilentbard:
Un bras noir parcouru de reflets métalliques, recouvert de lames tranchantes et de pointes acérées, pendait le long du flanc monstrueux. La main tenait une épée à deux tranchants dont la pointe se trouvait à quelques centimètres au-dessus du sol. La main et l'épée semblaient réunies dans une symbiose cauchemardesque, inséparables soeurs siamoises. Homme devenu machine, cet être damné représentait l'apogée de l'évolution humaine, juge et bourreau à la fois.
L'autre bras était tendu rigidement devant le juge, exsudant une impression de puissance formidable, telle que rien ne pouvait le faire vaciller. La main droite serait en une étreinte implacable la gorge de la poétesse, surprise. En cinq point de la nuque et de la gorge, les griffes faisaient perler le sang, rosée perdue sur un pétale d'orchidée. Trois gouttes tachetaient la page ouverte du livre projeté au sol, tel des points de suspension de mauvaise augure.
“Vous avez été prévenue, Silénus,” condamne l'hybride d'une voix rauque et posée. “Néanmoins vous avez désobéie et vous devez donc être punie.”
La poétesse regarda autour d'elle. Ses yeux accueillirent lentement la vision des tomes rangés sur les rayons penchés des meubles antiques. Ils s'attardèrent un instant sur une fenêtre à l'arc brisé, au travers de laquelle elle pouvait voir le soleil mourrant sous un voile de nuages noirs et massifs défilant rapidement à l'horizon et qui répandait, comme un cœur perforé, sa lueur rouge sur le paysage.
Cette ruine perdue dans la zone interdite recelait donc effectivement bien plus que des grimoires moisis et déchirés. Ce savoir antique semblait poser un véritable dilemme au gouvernement… Cependant, il semblait étrange qu'un juge soit envoyé en ces lieux, alors qu'aucune patrouille ne s'y aventurait plus depuis des générations.
La poétesse réalisait progressivement l'importance de sa découverte des derniers jours. Elle se sentait toute proche du but. Comprendre les phénomènes dont parlent ces livres, s'extraire de la non-vie, de l'amputation émotionnelle à laquelle est livrée chaque citoyen dès son enfance. Connaître une alternative…
- Vous avez le choix: amnésie ou mort.
Panique soudaine. Terreur. Tout ce qu'elle avait appris lui serait ôté! Un niveau de conscience supérieur allait lui être refusé!
Des images de gens qu'elle… aimait? … lui filèrent devant les yeux. Un sentiment de tristesse sembla poindre...
Puis, elle comprit. La peur laissa place à une euphorie farouche, effaçant la douleur de la poigne d'acier. Finalement sereine, elle prononça d'une voix calme sa sentence.
- Je choisis de connaître.
:thesilentbard:
Dernière édition par Christoph le 05 Fév 2004, 12:44, édité 1 fois.
- Christoph
- modo-admin
- Message(s) : 2949
- Inscription : 07 Sep 2002, 18:40
- Localisation : Yverdon, Suisse
Oups, j'avais pas vu ça. J'aurais du répondre y a un moment.
Bon ben... franchement, heureusement que c'est court, en ce qui me concerne, parce que je trouve ça vachement ampoulé.
Le coup du pétale d'orchidée, c'est... on dirait l'intro d'une nouvelle de White Wolf, je sais pas le dire autrement, c'est du "dark-romantique" telelment appuyé que si on adhère pas (comme moi), on rit.
Mais au-delà du fait que j'accroche pas, que je trouve ça grandiloquent et super "facile" sur le fond, la forme (puisque c'était la question que tu m'avais posé) est par contre beaucoup plus cohérente, y a même un truc que je trouve redoutable, c'est la première phrase : tu fais une description du bras, bon, pourquoi pas, c'est pas telelment détaillé mais on voit bien où ça va et tu termines sur "pendait le long du flanc monstrueux".
He ben c'est drôle,mais ce falnc est beaucoup plus marquant que ce qui a précédé (mais grâce à ce qui a précédé). C'est le bout que tu décris le moins qu'on voit le mieux.
Stylistiquement, ça m'a donné une idée : pour décrire un truc vraiment affreux , la méthonymie, c'est redoutable. On décrit juste unpetit bout, on donne une indication sur l'ampleur du "reste" et hop, c'est efficace.
Juste un truc, encore : autant que possible, que ce que tu décris ne soit pas "objet", mais sujet.
La pointe de l'épée, par exemple : elle "se trouve pas" à un endroit, c'est pas ni une action ni un état, ça, c'est rien : elle oscille, elle est figée, elle attend... mais "elle se trouve" pas.
Bon ben... franchement, heureusement que c'est court, en ce qui me concerne, parce que je trouve ça vachement ampoulé.
Le coup du pétale d'orchidée, c'est... on dirait l'intro d'une nouvelle de White Wolf, je sais pas le dire autrement, c'est du "dark-romantique" telelment appuyé que si on adhère pas (comme moi), on rit.
Mais au-delà du fait que j'accroche pas, que je trouve ça grandiloquent et super "facile" sur le fond, la forme (puisque c'était la question que tu m'avais posé) est par contre beaucoup plus cohérente, y a même un truc que je trouve redoutable, c'est la première phrase : tu fais une description du bras, bon, pourquoi pas, c'est pas telelment détaillé mais on voit bien où ça va et tu termines sur "pendait le long du flanc monstrueux".
He ben c'est drôle,mais ce falnc est beaucoup plus marquant que ce qui a précédé (mais grâce à ce qui a précédé). C'est le bout que tu décris le moins qu'on voit le mieux.
Stylistiquement, ça m'a donné une idée : pour décrire un truc vraiment affreux , la méthonymie, c'est redoutable. On décrit juste unpetit bout, on donne une indication sur l'ampleur du "reste" et hop, c'est efficace.
Juste un truc, encore : autant que possible, que ce que tu décris ne soit pas "objet", mais sujet.
La pointe de l'épée, par exemple : elle "se trouve pas" à un endroit, c'est pas ni une action ni un état, ça, c'est rien : elle oscille, elle est figée, elle attend... mais "elle se trouve" pas.
- Wenlock
- Message(s) : 301
- Inscription : 27 Déc 2003, 11:42
Merci pour cet avis franc ;)
C'est marrant, parce que à un moment je demandais aux gens de l'atelier si ce n'étais pas un peu abusé niveau tragique, au point d'en devenir ridicule, et les gens de me dire que non... du coup je n'avais plus retouché :D
Je pense pas refaire un texte aussi dramatique avant un bon moment (moi le truc qui m'énervait le plus c'est le coup "du niveau de conscience supérieure", je trouve ça ridicule, mais je n'ai pas trouvé autre chose pour exprimer l'idée...)
Bonne remarque sur les descriptions plus "actives", plutôt que "passives" (en tout cas c'est ce que j'ai compris, et ça va dans le sens d'autres remarques de ta part et d'autres lecteurs).
Je n'avais pas remarqué la puissance évocatrice de la méthonymie, merci. Ce qui me fait d'autant plus plaisir c'est que c'est justement un "truc" que je voudrais maîtriser.
Encore merci pour tes commentaires ;)
Le prochain texte est moins tragique et moins dark. Je ne sais pas encore quand je vais le mettre. Il est aussi plus long...
C'est marrant, parce que à un moment je demandais aux gens de l'atelier si ce n'étais pas un peu abusé niveau tragique, au point d'en devenir ridicule, et les gens de me dire que non... du coup je n'avais plus retouché :D
Je pense pas refaire un texte aussi dramatique avant un bon moment (moi le truc qui m'énervait le plus c'est le coup "du niveau de conscience supérieure", je trouve ça ridicule, mais je n'ai pas trouvé autre chose pour exprimer l'idée...)
Bonne remarque sur les descriptions plus "actives", plutôt que "passives" (en tout cas c'est ce que j'ai compris, et ça va dans le sens d'autres remarques de ta part et d'autres lecteurs).
Je n'avais pas remarqué la puissance évocatrice de la méthonymie, merci. Ce qui me fait d'autant plus plaisir c'est que c'est justement un "truc" que je voudrais maîtriser.
Encore merci pour tes commentaires ;)
Le prochain texte est moins tragique et moins dark. Je ne sais pas encore quand je vais le mettre. Il est aussi plus long...
- Christoph
- modo-admin
- Message(s) : 2949
- Inscription : 07 Sep 2002, 18:40
- Localisation : Yverdon, Suisse
Artanis a écrit :Merci pour cet avis franc ;)
De rien. Par contre, le jour où tu voudras un avis poli et mesuré, me demande pas, je sais pas faire. =D
C'est marrant, parce que à un moment je demandais aux gens de l'atelier si ce n'étais pas un peu abusé niveau tragique, au point d'en devenir ridicule, et les gens de me dire que non... du coup je n'avais plus retouché :D
C'est très difficile d'évaluer son oeuvre (au sens de "produit d'un ouvrage", pas tellement "d'oeuvre d'art", qui est un terme trop pontifiant à mon goût) sans se laisser influencer par les autres.
J'avais un ami qui faisait du théâtre : plus il en rajoutait, plus il surjouait, plus la salle applaudissait. Quand il ne demandait mon avis je lui répondais que non seulement son jeu devenait "creux", mais qu'il y avait peu de gloire dans la surenchère et qu'il devrait employer son talent (qui était réel) à s'exercer dans la "justesse".
Il me répondait "oui, mais la justesse, la plupart de ces gens sont incapables de la voir, si je veux qu'ils soient content et qu'ils applaudissent, faut que j'en rajoute". On trouvait tous les deux ça désespérant.
Par contre, dans le tragique, dans le kitsch même, il y a des choses à faire, à apprendre.
Le point de basculement entre le sublime et le ringard est très difficile à trouver, je sûr d'avoir été moi-même souvent ridicule de ce point de vue.
Je pense pas refaire un texte aussi dramatique avant un bon moment (moi le truc qui m'énervait le plus c'est le coup "du niveau de conscience supérieure", je trouve ça ridicule, mais je n'ai pas trouvé autre chose pour exprimer l'idée...)
Nouvelle technique (secrète de clan) : quand la prose n'offre que des alternatives insatisfaisantes, il est temps de passer à la poésie, à l'analogie, à la métaphore...
On pourrait remplacer par "tout un monde" (encore un peu grandiloquent, j'admets), ou le très général "un idéal". Quelles sont précisément les notions que tu mets dans ce terme (j'avoue qu'il est pas facile à remplacer).
Au fait : dans le genre grand guignol "Je choisi de connaître. (tatiiiiiiiiin)", c'est pas mal non plus... :lol:
Bonne remarque sur les descriptions plus "actives", plutôt que "passives" (en tout cas c'est ce que j'ai compris, et ça va dans le sens d'autres remarques de ta part et d'autres lecteurs).
Oui, c'est ça. Sauf que "active" suppose une action, alors que l'objet de ta description, pour devenir sujet, peut aussi subir une action ou se trouver dans un "état" particulier. Dans le cas de l'épée, la pointe est semble-t-il suspendue au dessus du sol (ok, la figure de style est bateau, mais c'est ça que ça veut exprimer : elle résiste à la gravité, elle "tient en l'air" de manière fixe, rigide).
Au fait, tu es conscient du côté "freudien" de cette description là, justement ?
Je n'avais pas remarqué la puissance évocatrice de la méthonymie, merci. Ce qui me fait d'autant plus plaisir c'est que c'est justement un "truc" que je voudrais maîtriser.
Ben, me semble que t'as le bon instinct.
Le prochain texte est moins tragique et moins dark. Je ne sais pas encore quand je vais le mettre. Il est aussi plus long...
Quand tu veux, je tâcherais de réagir plus rapidement.
Tiens, pour rire :
"De la suite de la guerre tu ne verras plus que les colonnes de prisoniers qu'on transfert vers l'Allemagne et la beuverie des soldats le 16 juin lorsqu'on annonce la réddition de la France.
Tu es incarcéré au Stalag 12, à Bensheim, où, n'étant que sous-officier, tu ne peux échapper au travail : de 12 à 14h par jour à remuer le sable et la chaux dans une cimmenterie. Il y a là, en plus des militaires, une poignée de prisonniers politiques, principalement des communistes allemands, hollandais et belges, qui attendent leur transfert vers les "camps d'internement".
La nourriture vous arrive moisie, les installations sanitaires sont réduites au minimum.
Tous les jours vous êtes réveillés à 6h et les officiers prisonniers font l'appel des "travailleurs volontaires" (c'est à dire tout le monde, pusique le travail volontaire est... obligatoire) qui, après un bol de soupe et un croûton de pain, se rendent à la cimmenterie.
Le soir on dort. Un peu. On rêve parfois, toi par exemple tu rêves des aigles dans les montagnes, du ciel, des étés, du dehors.
Au Stalag il n'y a pas de temps. Pas d'espace non plus : les couloirs, les baraquements, les clôtures, les bâtiments gris carrés juste juxtaposés, comme des photos. Tout est plat, on sent pas le vent. Pas de courrier bien sûr.
Même les gens sont gris, la gueule ou l'uniforme. C'est un monde de chiffre : les sacs de ciment, les matricules, les horaire toujours les mêmes. Pas de saison non plus. Il paraît qu'on est déjà en février. 9 mois. Pourtant rien ne bouge.
Les journées ont la même longueur, il n'y a pas de midi, de soir ou d'aube sous les lampes au phosphore.
On rêve d'un dehors. On murmure, on se raconte des histoires, qu'on va être échangés contre des travailleurs volontaires, des vrais peut-être, qui viendront de France pour prendre votre place ; faudrait être bien con.
Alors on se fabrique un but, tout doucement, une évasion, le grand fantasme qui fait rêver bien mieux que toutes femmes qu'on raconte dans les dortoirs avant de dormir, des jeunes filles, des épouses, des mères aussi pour ceux qui sont encore presque enfant.
La chaux attaque les mains, les yeux et les poumons, petit à petit on tousse plus sec, on ne peut plus pleurer. On n'a plus ni goût ni odorat sans doute, mais avec l'eau ferreuse et le pain sec on ne s'en rend pas compte.
On ne vit pas, on attends. On meurt doucement, on se rapetisse.
Pour certains c'est insupportable, pour au moins trois types qui veulent rester humains. Donc se faire la belle.
Depuis des mois qu'on accumule les petits outils piqués aux ateliers, qu'on les polit pour les rendre assez tranchant pour mordre le barbelés. Vous aussi vous notez des chiffres : des horaires, des angles morts.
Trois candidats au départ, Eboyan l'Arménien, un ancien du Reco, un silencieux, Borrel le caporal de 22 ans, un breton, un colérique qui s'étouffent au Stalag. Et toi.
Ca s'est fait une nuit : quitter le baraquement en retirant 2 planches du sol, à ras du mur, ramper, atteindre le grillage vite, profiter des ombres, les soldats font mal leur travail et les patrouilles se raréfient avec le froid. Une chance.
Coupez le fil de fer, le plus près possible du sol pour que ça ne se voit pas tout de suite, pour traverser le terrain vague en éviatnt les boches et les chiens, jusqu'au second grillage. On coupe encore. C'est long, trop long. Vient la lumière, les coups de feu, la course dans les bois.
Un instant on y croit.
Et puis le choc, le dos qui se déchire, le sol froid contre ton visage, les aboiements.
Repris."
Comme ça, toi aussi tu vas pouvoir critiquer ce que j'écris. Je te dirais ensuite d'où ça sort.
- Wenlock
- Message(s) : 301
- Inscription : 27 Déc 2003, 11:42
Par contre, le jour où tu voudras un avis poli et mesuré, me demande pas, je sais pas faire. =D
Ce n'est pas mon genre de demander ce genre de choses ;)
Le point de basculement entre le sublime et le ringard est très difficile à trouver, je sûr d'avoir été moi-même souvent ridicule de ce point de vue.
Tellement vrai.
Nouvelle technique (secrète de clan) : quand la prose n'offre que des alternatives insatisfaisantes, il est temps de passer à la poésie, à l'analogie, à la métaphore...
... tu peux voir qq essais de poésie dans ce forum...
voilà quoi :roll:
je planche actuellement sur un petit vers un peu abstrait. quand je serais mons dissatisfait, je le posterai peut-être
u fait : dans le genre grand guignol "Je choisi de connaître. (tatiiiiiiiiin)", c'est pas mal non plus... :lol:
Effectivement... mais c'était essentiel =D
actif vs passif
j'ai oublié de préciser que je parlais du sens grammatical de ces termes...
manger vs être mangé
Au fait, tu es conscient du côté "freudien" de cette description là, justement ?
T'es le pire toi! Je dois effectivement être assez latent... heureusement que je n'ai pas foutu de cape :D
anecdote: la première version c'était un poète et non une poétesse... :vomir:
Ben, me semble que t'as le bon instinct.
Merci ;)
Pour ton texte, pourquoi ne pas ouvrir ton propre thread ;)
Je te dis ce que je comprends:
J'aime bien la narration à la 2e personne, ça m'a surpris et interpellé!
Suis tout de suite entré, c'est très crédible. On y est presque! Le vocabulaire est assez simple, ce qui colle très bien avec l'austérité de la situation. Les phrases un peu abbrégées m'ont fait pensé que cette scène est racontée par qqn, ou du moins c'est qqn qui repensait à ce qui (lui?) était arrivé. Le temps de l'action (le présent) va aussi bien dans ce sens.
Un instant on y croit.
Et puis le choc, le dos qui se déchire, le sol froid contre ton visage, les aboiements.
Repris.
C'est puissant! Surtout la phrase que j'ai mis en gras. je n'arrive pas très bien à expliquer, mais le fait que la chute est ellipsée (?), ça donne. "les aboiements" n'a à priori rien à voir dans cette phrase, mais j'aime bien. evt il y a le "Et" qui me dérange... quoique...
Cependant, il y a parfois des énumérations qui m'ont confues à la première lecture. La multitude de périphrases (c'est bien comme ça qu'on appelle les petits pseudo-phrases séparées par des virgules, et sensées apporter un complément d'infos?) rend la lecture un peu moins fluide. Mais finalement, ce n'est pas vraiment un défaut. Ca cadre assez bien avec l'ambiance (et avec l'effet "dans les souvenirs du type").
Voilà tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Malheureusement pour toi, je ne sais pas analyser un texte aussi finement que toi. Je te livre donc mes impressions sur le vif, ça peut evt t'aider à voir comment est perçu le texte.
- Christoph
- modo-admin
- Message(s) : 2949
- Inscription : 07 Sep 2002, 18:40
- Localisation : Yverdon, Suisse
Artanis a écrit :Ce n'est pas mon genre de demander ce genre de choses ;)
Tant mieux, ça va faciliter la discussion. :jap:
... tu peux voir qq essais de poésie dans ce forum...
voilà quoi :roll:
je planche actuellement sur un petit vers un peu abstrait. quand je serais mons dissatisfait, je le posterai peut-être.
Je parle pas de texte purement poétique, mais l'introduction d'un pil de poésie dans un texte narratif. Bon, pas dans les descriptions de coucher de soleil (urk!), mais lorsque le mot manque à la prose.
C'est quand-même vachement pratique parce que la poésie, les figure de style permettent parfois d'exprimer des sens plus variés, plus "efficaces" que la prose, traduire une plus grande subjectivité.
Effectivement... mais c'était essentiel =D
J'admets. C'est ça qui est casse-gueule : exprimer quelque chose de fort sans le dévaluer par la forme. Avec le même pote comédien on a longtemps causé de la dernière réplique de "Cyrano de Bergerac" ("Il me reste...... mon panache!" et crac le mec i meurt) pour savoir si c'était sublime ou ridifesse. Je reste persuader que c'est l'interprétation de l'acteur qui fera la différence (pour moi, dans l'idéal, ça se murmure une phrase comme ça).
T'es le pire toi! Je dois effectivement être assez latent... heureusement que je n'ai pas foutu de cape :D
anecdote: la première version c'était un poète et non une poétesse... :vomir:
Bah justement (à moins que tu veuilles exprimer un forme d'homosexualité, mais c'est moins transparent alors), le coup du grand balaise qui teint la femme dans une main et son épée suspendue en l'air dans l'autre (surtout vu la complaisance avec laquelle tu décris l'épée), c'est d'autant plus flagrant ! :D
Mais c'est pas grave, hein, c'est même potentiellement très utile, ce genre d'allusion.
Pour ton texte, pourquoi ne pas ouvrir ton propre thread ;)
Bof.
Je te dis ce que je comprends:
J'aime bien la narration à la 2e personne, ça m'a surpris et interpellé!
Suis tout de suite entré, c'est très crédible. On y est presque! Le vocabulaire est assez simple, ce qui colle très bien avec l'austérité de la situation. Les phrases un peu abbrégées m'ont fait pensé que cette scène est racontée par qqn, ou du moins c'est qqn qui repensait à ce qui (lui?) était arrivé. Le temps de l'action (le présent) va aussi bien dans ce sens.
C'est puissant! Surtout la phrase que j'ai mis en gras. je n'arrive pas très bien à expliquer, mais le fait que la chute est ellipsée (?), ça donne. "les aboiements" n'a à priori rien à voir dans cette phrase, mais j'aime bien. evt il y a le "Et" qui me dérange... quoique...
Ah oui, tiens, c'est vrai, la phrase gagnerait en rythme si je virais le "Et".
"Puis le choc, le dos..." c'est plus efficace. Noté, pour la prochaine fois (il est un peu tard pour retoucher ce texte, voir plus bas).
Cependant, il y a parfois des énumérations qui m'ont confues à la première lecture. La multitude de périphrases (c'est bien comme ça qu'on appelle les petits pseudo-phrases séparées par des virgules, et sensées apporter un complément d'infos?) rend la lecture un peu moins fluide. Mais finalement, ce n'est pas vraiment un défaut. Ca cadre assez bien avec l'ambiance (et avec l'effet "dans les souvenirs du type").
Voilà tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Malheureusement pour toi, je ne sais pas analyser un texte aussi finement que toi. Je te livre donc mes impressions sur le vif, ça peut evt t'aider à voir comment est perçu le texte.
Ben oui, c'est principalement ce que j'en attendais.
Attention surprise : ce truc est un extrait de JdR par mail. :lol:
(Partie "Résistances")
Le joueur a peu de liberté d'action dans cette partie de l'introduction, le but étant surtout de placer l'ambiance et de lui transmettre les infos recueillies durant la captivité de son perso (un soldat français).
C'était juste pour illustrer la façon dont j'essayais de traduire une certaine subjectivité d'une manière que j'espérais "efficace".
Mais s'il me reprend l'envie d'écrire de vrais textes narratif qui cadre dans l'esprit du forum, je créerai un thread, promis. ;)
- Wenlock
- Message(s) : 301
- Inscription : 27 Déc 2003, 11:42
Je parle pas de texte purement poétique, mais l'introduction d'un pil de poésie dans un texte narratif. Bon, pas dans les descriptions de coucher de soleil (urk!), mais lorsque le mot manque à la prose.
C'est quand-même vachement pratique parce que la poésie, les figure de style permettent parfois d'exprimer des sens plus variés, plus "efficaces" que la prose, traduire une plus grande subjectivité.
je peine à comprendre de quoi tu parles au juste :-k
pour le coucher du soleil tu dis ça à cause que c'est cliché?
C'est ça qui est casse-gueule : exprimer quelque chose de fort sans le dévaluer par la forme. Avec le même pote comédien on a longtemps causé de la dernière réplique de "Cyrano de Bergerac" ("Il me reste...... mon panache!" et crac le mec i meurt) pour savoir si c'était sublime ou ridifesse. Je reste persuader que c'est l'interprétation de l'acteur qui fera la différence (pour moi, dans l'idéal, ça se murmure une phrase comme ça).
Plutôt d'accord avec ce que tu dis ;)
Bah justement (à moins que tu veuilles exprimer un forme d'homosexualité, mais c'est moins transparent alors), le coup du grand balaise qui teint la femme dans une main et son épée suspendue en l'air dans l'autre (surtout vu la complaisance avec laquelle tu décris l'épée), c'est d'autant plus flagrant !
Mais c'est pas grave, hein, c'est même potentiellement très utile, ce genre d'allusion.
T'en vois des choses toi! :o
Ben en fait, dans la logique des choses, cet hybride est plutôt assexué, puisqu'il est le "summum" de l'évolution d'une pensée qui a détruit toute forme de sentiments et émotions.
Euh, ça veut dire quoi "complaisance" exactement?
Attention surprise : ce truc est un extrait de JdR par mail.
arghl, j'avais même pas pensé au jdr! :oops:
ça fait trop longtemps que je n'ai plus joué :pleurs:
tu mastérises quoi à la convention? =D
- Christoph
- modo-admin
- Message(s) : 2949
- Inscription : 07 Sep 2002, 18:40
- Localisation : Yverdon, Suisse
moi j aime bien personnellement...
Au long de mes paupières amères,
S'écoulent des larmes glacées,
Qui dérivent au fil de mes vers,
Vers le ruisseau de mes pensées...
Vous aussi participez à l'Orbe de la Flamme Noire:
http://fr.groups.yahoo.com/group/blackflameorb
S'écoulent des larmes glacées,
Qui dérivent au fil de mes vers,
Vers le ruisseau de mes pensées...
Vous aussi participez à l'Orbe de la Flamme Noire:
http://fr.groups.yahoo.com/group/blackflameorb
- nemesis
- Message(s) : 209
- Inscription : 07 Août 2003, 10:25
- Localisation : Paris
Artanis a écrit :je peine à comprendre de quoi tu parles au juste :-k
pour le coucher du soleil tu dis ça à cause que c'est cliché?
Ca l'est assez en soi pour ne pas avoir à subir de poésie par dessus, oui, mais en plus c'est parce que j'ai récemment lu une description de couhcer de soleil dans un bouquin, et c'était vraiment le seul truc à jeter de tout le roman.
T'en vois des choses toi! :o
Ben en fait, dans la logique des choses, cet hybride est plutôt assexué, puisqu'il est le "summum" de l'évolution d'une pensée qui a détruit toute forme de sentiments et émotions.
Euh, ça veut dire quoi "complaisance" exactement?
"En m'attardant beaucoup et avec un plaisir évident".
J'ajouterai que si ton personnage est asexué, toi tu ne l'es pas, d'où pertinence de l'analyse. (Parmi les avantages de cette "lecture pyschanalytique" des textes : être capable de le voir chez soi et d'apprendre des trucs de soi, être capable de le repérer et de le virer quand ça contredit ce qu'on voulait faire, être capable de lui laisser libre cours ou de l'utiliser dans les cas ou ça ajoutera au texte).
tu mastérises quoi à la convention? =D
Sais pas encore, peut-être bien "Dying Earth" avec Ego' et Thunk (on ferait alors un multi-tables), sinon je sais pas, j'ai des idées vagues, rien de précis. Mais je vais tenter un truc un peu expérimental, sûrement.
- Wenlock
- Message(s) : 301
- Inscription : 27 Déc 2003, 11:42
moi j aime bien personnellement...
quoi donc? :siffle:
Ca l'est assez en soi pour ne pas avoir à subir de poésie par dessus, oui, mais en plus c'est parce que j'ai récemment lu une description de couhcer de soleil dans un bouquin, et c'était vraiment le seul truc à jeter de tout le roman.
Soit, j'y penserais à l'avenir, mais je le garderai ici, j'aime bien l'effet mirroit à plus grande échelle :cool:
"En m'attardant beaucoup et avec un plaisir évident".
Faut dire que j'étais assez fier de cette phrase (concernant l'épée) la première fois que je l'ai couchée sur le papier. En fait, il en va de même pour d'autres phrases. Donc cette définition sied à merveille \:D/
L'analyse est effectivement qqch que je devrai tenter :)
Le prochain texte risque de révéler de l'Oedipe à tour de bras =D
- Christoph
- modo-admin
- Message(s) : 2949
- Inscription : 07 Sep 2002, 18:40
- Localisation : Yverdon, Suisse
Faut dire que j'étais assez fier de cette phrase (concernant l'épée) la première fois que je l'ai couchée sur le papier. En fait, il en va de même pour d'autres phrases. Donc cette définition sied à merveille \:D/
L'analyse est effectivement qqch que je devrai tenter :)
Le prochain texte risque de révéler de l'Oedipe à tour de bras =D
Rien que de plus banal, cher ami. De plus les névroses sont non seulement l'une des choses les plus communes à l'espèce humaine (donc facile de communiquer en s'en servant), mais en plus c'est très créatif... =D
- Wenlock
- Message(s) : 301
- Inscription : 27 Déc 2003, 11:42
ouais ouais... =D
bon, aujourd'hui j'ai droit à une petite critique de mon dernier texte, suite à quoi je le posterai. :jap:
bon, aujourd'hui j'ai droit à une petite critique de mon dernier texte, suite à quoi je le posterai. :jap:
- Christoph
- modo-admin
- Message(s) : 2949
- Inscription : 07 Sep 2002, 18:40
- Localisation : Yverdon, Suisse
13 message(s)
• Page 1 sur 1
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité